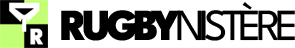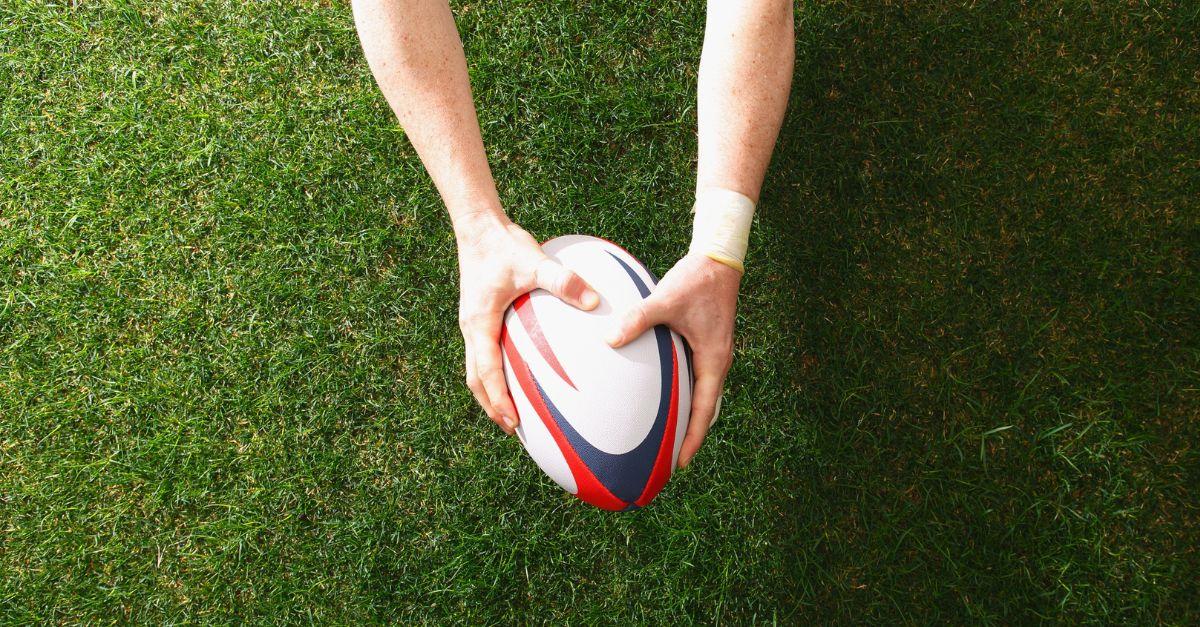C’est une question que peu de gens se posent vraiment, tant la réponse semble évidente : “Parce que c’est comme ça.” Et pourtant, la forme du ballon de rugby n’est ni une fantaisie ni un simple héritage visuel. Elle est le fruit d’une évolution étrange, presque accidentelle au départ, mais qui a fini par façonner l’un des symboles les plus reconnaissables du sport mondial.
Des vessies de porc aux débuts d’une légende
Revenons au XIXe siècle, dans la petite ville anglaise de Rugby — oui, celle-là même qui a donné son nom au sport. C’est là que William Gilbert, bottier de son état, commence à fabriquer des ballons pour les élèves de la Rugby School. On est autour des années 1820. À l’époque, pas de chambre à air en latex ni de surface texturée : on utilise des vessies de porc gonflées à la bouche, puis recouvertes de cuir.
Et voilà le point de départ : ces vessies n’étaient pas parfaitement rondes. Plutôt allongées, un peu asymétriques. Un hasard de l’anatomie porcine, devenu la norme d’un sport.
“Le rugby n’a pas choisi l’ovale : c’est l’ovale qui a choisi le rugby.”
Une forme née d’un besoin… et d’un accident
On raconte que lors d’un match à la Rugby School, un certain William Webb Ellis aurait, en 1823, décidé de ramasser le ballon à la main et de courir avec. Vrai ? Faux ? Peu importe. Ce geste — légendaire ou non — marque la rupture avec le football de l’époque. Le rugby se construit autour d’une autre idée du jeu, où le port du ballon devient central.
Et très vite, la forme du ballon commence à poser problème. Trop rond, il est difficile à plaquer, compliqué à tenir. Il roule trop loin, échappe des mains. William Gilbert l’a bien compris : il faut adapter l’outil au geste. Vers 1835, il modifie peu à peu la forme pour tendre vers quelque chose de plus effilé, inspiré… d’un œuf.
L’évolution technique : entre adaptation et invention
En parallèle, un autre artisan local, Richard Lindon, apporte une innovation décisive : il remplace la vessie de porc par une chambre à air en caoutchouc. Moins d’odeur, plus de contrôle, et surtout une forme que l’on peut standardiser. Il présente son idée à l’Exposition universelle de 1851.
“Un ballon rond suit une logique. Un ballon ovale suit son instinct.”
Petit à petit, la forme ovale s’impose. Non pas par décret, mais parce qu’elle colle au jeu. Elle facilite les passes. Elle se cale mieux sous le bras. Elle permet des rebonds imprévisibles — et c’est ce qui fait toute la beauté du rugby : cette part d’incertitude permanente.
Quand l’ovale devient la norme
Ce n’est qu’en 1877 que la Fédération anglaise officialise la forme du ballon. L’entreprise de Gilbert, à la même époque, produit déjà des milliers de ballons par an. Le succès est au rendez-vous, le style est adopté. Le rugby, sport jeune mais en pleine expansion, tient enfin son emblème.
La forme ovale devient non seulement un outil, mais une identité. Quinze ans plus tard, elle est adoptée à l’échelle internationale. Le rugby voyage : Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie… Et avec lui, ce ballon que personne n’essaiera plus de rendre rond.
On le retrouve dans des expositions thématiques organisées par des établissements comme les casinos aux plateformes de paris sportifs comme celles disponibles sur CritiqueJeu où les passionnés peuvent aujourd'hui suivre et pronostiquer sur les compétitions majeures de ce sport historique.
Le ballon moderne : de la tradition à la haute technologie
Aujourd’hui, le ballon n’a plus grand-chose à voir avec les prototypes en cuir cousus à la main. Fabriqué à partir de matériaux synthétiques, il est étanche, plus léger, plus résistant. Sa surface est texturée, presque granuleuse, pour éviter les fautes de main. Et ses dimensions sont strictement encadrées : 28 à 30 cm de long, une circonférence de 58 à 62 cm, un poids entre 410 et 460 grammes.
Des tailles différentes existent pour les plus jeunes, allant de la taille 1 pour les moins de 6 ans à la taille 5 pour les compétitions officielles.
Mais derrière cette précision, le principe reste le même : un ballon fait pour être porté, passé, botté — mais jamais vraiment maîtrisé.
Un objet devenu symbole
Au fil du temps, le ballon ovale est sorti des stades. Il trône dans les vitrines, les musées, les salons. Les modèles historiques signés Gilbert sont aujourd’hui recherchés par les collectionneurs. Certains se vendent à prix d’or. On le voit dans des expositions, sur des affiches, sur des logos. Il est devenu un totem culturel.
De la boue anglaise aux terrains synthétiques du Japon, des clubs amateurs aux Coupes du monde, ce ballon raconte une histoire. Celle d’un sport né d’un geste fou, et porté depuis par des millions de passionnés.